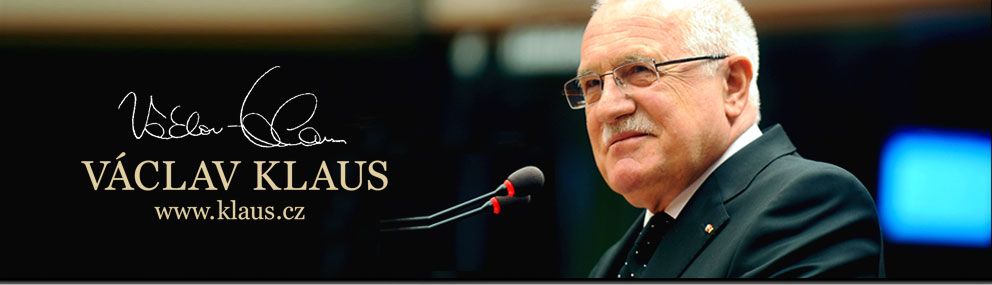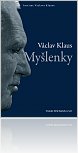Nejnovější
Nejčtenější
Hlavní strana » Pages Françaises » Václav Klaus: Le père des…
Václav Klaus: Le père des eurosceptiques
Pages Françaises, 30. 5. 2019
Le père des eurosceptiques.
Avant le Hongrois Viktor Orban, il y eut le Tchèque Vaclav Klaus. Premier ministre puis président de la République de 2003 à 2013, ce conservateur radical a semé en Europe centrale la graine de la défiance à l’égard de l’Union. Une figure tutélaire qui espère bien voir ses idées souverainistes triompher lors des prochaines élections.

Autor: Robin de Puy
VACLAV KLAUS A UNE MANIÈRE BIEN À LUI DE METTRE À L’AISE SES INTERLOCUTEURS. À peine est-on assis dans la magnifique maison servant de siège à son institut praguois que le Tchèque nous demande, avec son regard perçant, sur un ton sarcastique : « Le Monde existe encore ? »Le quotidien du soir, c’est tout ce qu’il abhorre : la France universaliste, l’engagement pro-européen et les journalistes. S’il a accepté de nous recevoir, courtoisement et longuement, c’est uniquement pour promouvoir son héritage politique dans ces terres francophones où, incompris, il eut bien du mal à trouver un écho. Il est heureux que ses vieux ennemis (les élites parisiennes, les « euronaïfs » et les gratte-papier, donc) se souviennent de lui. Nous le remercions de nous ouvrir sa porte, lui qui a presque systématiquement boycotté la presse occidentale. Vaclav Klaus, né en 1941, a été premier ministre (1993-1997) puis président de la République tchèque (2003-2013). Maintenant, cheveux et moustache immaculés, mise toujours impeccable, il anime son think tank, modestement nommé « Institut Vaclav Klaus », financé par la première fortune du pays, le milliardaire Petr Kellner, qui doit largement son succès aux privatisations sauvages orchestrées par M. Klaus, quand ce dernier fut au pouvoir.
Sa vie n’est pas celle d’un retraité. À bientôt 78 ans, il publie. Il organise des séminaires. Il participe à des conférences. Il est invité partout. Un jour à Amsterdam, l’autre à Pékin. Il a une qualité : la constance. Jamais ce conservateur n’aura changé d’avis. Ses convictions tiennent en deux mots : libre-échange économique et souveraineté politique. Elles auront plus imprégné la société tchèque que celles de son grand rival, l’autre Vaclav, Havel, mort en 2011, qui, le détestant cordialement, dénonçait son « provincialisme isolationniste » et « son égoïsme petit-bourgeois ».
Grâce ou à cause de lui, ses concitoyens ne sont plus que 33 % à considérer positivement leur appartenance à l’Union européenne. C’est nettement moins qu’en France (54 %), qui se situe dans la moyenne, ou au Luxembourg (86 %), l’État le plus europhile des 28. Certes, quand il leur a fallu se décider à rejoindre l’Union, en juin 2003, les Tchèques ont dit « oui » à 77,33 % (55,21 % de participation). Mais, à l’époque, déjà, les sondages à la sortie des urnes étaient tout sauf enthousiastes. Leurs cousins slovaques ayant sauté le pas avant eux, ils s’étaient sentis forcés de suivre le mouvement.
Il faut rendre à César ce qui lui appartient : nettement moins célèbre que son illustre compatriote Havel, le « professeur Vaclav », qui fut chercheur en économie, aura marqué l’histoire au moins autant que lui. Apprenti sorcier d’une cause qui le dépasse, ce fan de Margaret Thatcher, selon Jacques Rupnik, spécialiste de l’Europe centrale au Centre d’études et de recherches internationales de Sciences Po, fut le premier, au sommet du pouvoir, à distiller le lent poison du nationalisme. À l’époque, sa formule « lui permit de proposer une alternative politique à Vaclav Havel, parce que ce dernier occupait beaucoup d’espace politique et incarnait l’engagement européen », selon M. Rupnik.
« J’ai flairé son danger tout de suite », énonce-t-il doctement, début mai, dans un grand salon décoré avec soin. La vue sur les clochers praguois y est époustouflante. « Après quarante ans de socialisme, je ne voulais pas que nous intégrions une institution menaçant de minimiser de nouveau une souveraineté que nous venions juste de recouvrer. Hélas, nous n’avions pas la chance d’être nés helvètes. Jouir, comme la Suisse, d’un accès au marché commun sans nous dissoudre comme un sucre dans un nouvel ensemble était un luxe hors de portée. » C’est le drame de Vaclav Klaus : il aura accompagné, au long de sa carrière, un processus qu’il dénonçait. Lorsqu’on lui fait remarquer ce paradoxe, il affirme n’avoir pas eu le choix : il a dû se résoudre à faire entrer son pays dans l’Union européenne, même s’il était contre. « Mais j’ai toujours dit en rigolant que, dès la première heure du jour d’après l’intégration, nous devrions nous atteler à réaliser notre seconde “révolution de velours”, c’est-à-dire entrer en résistance, comme à la fin des années 1980, quand les Tchécoslovaques précipitèrent la chute de l’URSS. »
Dans son genre, outrancier et autoritaire, M. Klaus fut un pionnier. Toutes ces années à dénoncer pêle-mêle l’hystérie des écologistes sur le climat, la « folie de l’euro », à ferrailler contre la liberté de la presse, les politiques de santé publique, forcément antidémocratiques puisque « fumer est un droit »… Refuser de hisser le drapeau étoilé sur les toits du château de Prague, défendre la Russie de Poutine ou mépriser les ONG : le premier ministre hongrois Viktor Orban n’a donc rien inventé. « L’Europe est dominée par la gauche », se justifie aujourd’hui Vaclav Klaus. « En France, tout le monde est de gauche. En Allemagne, la CDU d’Angela Merkel est socialiste, même si elle n’a pas le courage de le dire. J’ai quitté le PPE [Parti populaire européen, la grande formation chrétienne-démocrate] il y a dix ans déjà, parce que je considérais qu’il n’était plus de droite. » Là encore, on croirait entendre Orban. Le Tchèque et le Hongrois sont des amis fidèles. Ils se rencontrent souvent, rêvant tous deux d’un retour en arrière. Pas de sortir purement et simplement de l’Union européenne, comme se destinent à le faire les Britanniques. Malheureusement, cela, les Tchèques ne peuvent se le permettre : ils sont encore trop dépendants des fonds européens, sans lesquels les régions les plus reculées d’Europe centrale auraient bien du mal à surnager. Mais, si l’Europe pouvait se limiter à une grande zone de libre-échange, alors là, oui, ils signeraient tout de suite.
POUR ASSISTER DE SON VIVANT À L’AGONIE d’une Commission européenne aux pouvoirs exorbitants, Vaclav Klaus a tenté avec une patience remarquable, il y a six ou sept ans, de rassembler « toutes les forces de droite ». « Cela n’a pas marché », soupire-t-il en affichant un grand regret. « Les Allemands de l’AfD ne voulaient pas discuter avec le Néerlandais Wilders, le Britannique Farage refusait de négocier avec Le Pen, l’Autrichien Strache n’adressait pas la parole à je ne sais qui. C’était très compliqué. » Il a labouré un terreau fertile, dans lequel « Orban l’héritier » et Matteo Salvini, l’Italien pragmatique, tenteront désormais de faire pousser et de récolter le fruit de son labeur. Après les élections européennes, peut-être verra-t-on pour la première fois des députés de droite et d’extrême droite s’allier au Parlement européen et former une coalition majoritaire susceptible d’envoyer enfin à Bruxelles une personnalité « patriote ». Cela constituerait, pour Klaus, l’unique espoir de terrasser « l’ennemi Macron », qui réclame « encore plus de centralisation et d’unification », car les Français « ont toujours été autoritaires ». Alors là, oui, il aurait l’impression que ses efforts n’ont pas été vains. Et pourrait raccrocher les gants.
Václav Klaus, BLAISE GAUQUELIN, 18 mai 2019 – M Le magazine du Monde
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.